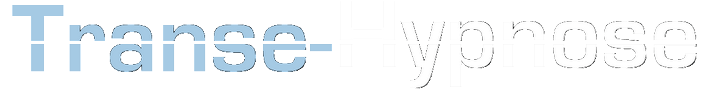Il faudrait peut-être préciser qu’il s’agit véritablement d’un « fétichisme de l’hypnose ».
C’est-à-dire de l’hypnose érotique pas simplement utilisé pour améliorer sa vie sexuelle, surmonter ses blocages,etc... mais bel et bien du fait d’être sexuellement excité par l’idée d’être hypnotiser, d’hypnotiser quelqu’un ou de voir quelqu’un se faire hypnotiser.
Il s’agit en général plus particulièrement de fantasmes de domination / soumission liés à l’image caricaturale de l’hypnose (se faire hypnotiser contre son gré), ou de jeux érotiques construit autours de cette idée.
Les américains, chez qui ce fantasme est un peu plus répandu qu’en Europe, ont même donné un nom précis à cela : « L’hypno-fetishism », ou « Erotic hypnosis » (parfois aussi, mais plus rarement, l’« hypnophilie »)
Il s’agit d’un fantasme beaucoup plus répandu qu’on ne pourrait le penser.
(J’avoue, si vous ne l’avez déjà compris : je suis moi-même hypnofétichiste).
Etonnamment, on en entend très peu parler !
Il y a eu une brève page là-dessus dans « Le sexe bizarre » d’Agnès Giard, et un roman écrit par Marie Nimier, « L’hypnotisme à la portée de tous » (Ed. Folio Gallimard), qui se rapproche assez de ce thème.
Bon, pour ceux qui voudraient en savoir plus, voilà une rubrique ouverte sur ce thème sur le site de « FetishInParis », qui vous aidera à vous faire une idée plus précise :
http://www.fetishinparis.com/index.php? ... =14&id=744
Je ne vais donc pas m’étendre sur la nature de ce fantasme sur ce forum, mais plutôt vous faire part de lecture que j’ai faîtes dans les ouvrages de psychanalyse classique pour repérer les passages susceptibles d’apporter un éclairage sur le lien spécifique entre hypnose et érotisme.
En résumé ?
Par nature, l’hypnotisme est fondamentalement d’ordre érotique et sexuel.
La séduction et l’état amoureux sont des formes d’hypnose, et réciproquement, l’hypnose est une forme de séduction et d’état amoureux.
Quoi de plus normal, dès lors, qu’il soit l’objet par excellence de fantasmes si attrayants…
« Dictionnaire international de la psychanalyse » (sous la direction d’Alain de Mijolla). Tome 1 : A-L. (Publié en 2002 aux éditions Calmann-Lévy). P. 584 :
«
Fascination
Fascination, communément, désigne l’action de fasciner ou le fait d’être fasciné. Fasciner, c’est immobiliser par la seule puissance du regard, c’est aussi charmer, enchanter, éblouir ou encore attirer et capter le regard.
En psychanalyse, cette notion équivaut pour Sigmund Freud à celle de sujétion amoureuse. Il désigne par ces termes la paralysie des facultés critiques, la dépendance, la soumission docile et la crédulité caractérisant certaines relations amoureuses ou aussi le rapport de l’hypnotisé à l’hypnotiseur.
Elle semble apparaître pour la première fois dans « Psychologie des masses et analyse du moi ». Fascination, sujétion amoureuse, c’est ainsi qu’on appelle, dit Freud, l’état amoureux dans ses développements les plus extrêmes. On peut penser qu’il reprend ce terme de Gustave Le Bon qu’il cite et qui avait fait remarquer, dans « Psychologie des foules », que l’individu dans une foule en vient à être dans un état particulier qui se rapproche de l’état de fascination de l’hypnotisé dans sa relation à l’hypnotiseur.
Si l’emploi du mot « Fascination » paraît n’intervenir qu’en 1921, ce qu’il définit en fait l’objet d’une réflexion ancienne qui avait amené rapidement Freud à rapprocher état amoureux et état hypnotique. Déjà en 1890, dans son article « traitement d’âme », constatant la docilité, l’obéissance et la crédulité de l’hypnotisé, il avait remarqué qu’une situation de ce genre trouve « un équivalent unique mais parfait dans certaines relations amoureuses caractérisées par un total abandon de soi ». En 1910, dans une note ajoutée aux « Trois essais sur la théorie sexuelle », il marque de nouveau cette concordance. En 1918, dans l’article « le tabou de la virginité », il discute la question de la « sujétion sexuelle », expression de Richard von Krafft-Ebing par laquelle celui-ci définit l’état d’assujettissement, de dépendance et de disparition de la volonté propre, vis-à-vis d’une personne avec qui est entretenu un commerce sexuel.
En 1921, ce qu’il caractérise par le terme de « fascination » n’est donc pas nouveau, pas plus que la concordance qu’il fait valoir entre cet état et celui de l’hypnotisé : même paralysie des facultés critiques, même docilité, même soumission, dit-il, envers l’objet aimé ou l’hypnotiseur. Ces constats ouvrent la voie au problème du rapport imaginaire de soi à l’autre aimé et / ou qui fait autorité et, par-delà, portent à penser la fascination comme une fonction essentielle au phénomène de la constitution du Moi, ce qu’avance Jacques Lacan.
La fonction du regard est centrale dans la fascination, aussi peut-on s’étonner que ce terme n’apparaisse pas dans l’article de 1922 sur « La tête de Méduse », alors que c’est un phénomène comparable de paralysie (de la pensée, du jugement, mais aussi du corps) que provoque, dans le mythe, la rencontre du regard de Gorgô. Ici trouve son acmé la fascination hypnotique mortelle attribuée à la puissance du regard porteur et vecteur de la toute-puissance des pensées », tel « le mauvais œil » dont Freud avait proposé une analyse en 1919 dans « L’inquiétante étrangeté ». De même, on peut s’étonner du fait suivant : qu’à propos de Baubô qu’il donne à voir en 1916 comme une représentation de castration, ou de la tête de Méduse qu’il interprète avec Sàndor Ferenczi comme une représentation des organes génitaux féminins et plus précisément de la mère, ne soit pas explicitement posée la question de la fascination et de ce qui peut l’engendrer : la vue du sexe féminin et la représentation de castration que cette vue appelle.
Catherine Desprats-Péquignot
Bilbiographie :
- Sigmund Freud. « Psychologie des masses et analyse du Moi »
- Sigmund Freud. « Trois essais sur la théorie sexuelle »
»
Sàndor Ferenczi souligne également la nature fortement érotique de l’hypnose, mais en y ajoutant un élément : le désir inconscient de revenir en enfance.
Sàndor Ferenczi. « Psychanalyse. Œuvres complètes » (éditions Payot)
Tome I (1908-1912). Chap. VIII : « Transfert et introjection ». Section II : « Rôle du transfert dans l’hypnose et la suggestion » (P. 112-114 & 119), écrite en 1909 :
«
La possibilité d’être hypnotisé ou suggestionné dépend donc de la capacité de transfert, c’est-à-dire, pour s’exprimer clairement, de la capacité du sujet d’adopter par rapport à l’hypnotiseur une position sexuelle, fût-elle inconsciente ; or la racine la plus profonde du transfert, comme tout amour objectal, provient des complexes parentaux.
(…)
Dans l’hypnose, il faut savoir commander avec une telle assurance que l’idée de résistance ne puisse même pas venir à l’esprit du sujet. Une forme extrême de cette sorte d’hypnose est « l’hypnose de frayeur » (« Ueberrumplungs-Hypnose ») provoquée par des cris, la menace, et si nécessaire, un ton sévère, des expressions grimaçantes, le poing brandi. Cette terreur – comme autrefois la vue de la tête de la Méduse – peut entraîner chez l’individu prédisposé une réaction immédiate de paralysie ou de catalepsie.
Mais il existe aussi une tout autre méthode pour endormir un sujet, dont les accessoires sont : la pénombre d’une pièce, le silence, la douce persuasion amicale au moyen de paroles monotones, mélodieuses (l’on y accorde en général une grande importance), et enfin des gestes caressants sur les cheveux, le front et les mains.
D’une façon générale, nous avons donc deux méthodes à notre disposition pour hypnotiser un individu, pour le soumettre à la suggestion, c’est-à-dire le forcer à une obéissance inconditionnelle, une confiance aveugle : l’intimidation et la tendresse. Les hypnotiseurs professionnels qui employaient la méthode bien avant que la science ne la reconnaisse, et qui en sont les véritables inventeurs, ont choisi semble-t-il instinctivement et jusque dans les plus petits détails, les mêmes modes d’intimidation et de douceur pour endormir le sujet et le contraindre à l’obéissance, que ceux qui, depuis des millénaires, font leurs preuves dans la relation entre parents et enfants.
L’hypnotiseur au physique imposant qui provoque l’état d’hypnose par intimidation et agression ressemble certainement beaucoup à l’image que l’enfant se fait du père tout-puissant, ce père que tout enfant a l’ambition de croire, d’obéir et d’imiter. Et la main douce et caressante, les paroles gentilles, monotones, apaisantes, ne sont-elles pas la répétition de ce qui s’est déroulé près du berceau de l’enfant, entre lui et sa bonne mère ou nourrice, qui le berçait de chants ou d’histoires, Et que ne ferait un enfant pour complaire à sa mère ?
Je n’accorde pas une très grande importance à une distinction rigoureuse entre hypnose paternelle et maternelle, car il arrive bien souvent que père et mère changent de rôle. Je veux seulement montrer combien la situation produite par l’hypnose est propre à évoquer, consciemment ou inconsciemment, l’enfance dans l’esprit du sujet, et à éveiller en lui ces souvenirs liés à l’époque de l’obéissance enfantine si vivants en tout être humain.
Les procédés d’endormissement par excitation soi-disant extérieure : présentation d’un objet lumineux devant les yeux, ou tic-tac d’une montre près de l’oreille, sont justement les premiers qui ont servi autrefois à fixer l’attention du nourrisson ; ces excitations extérieures sont donc également tout particulièrement propres à évoquer des souvenirs et des affects infantiles.
Même ceux que la psychanalyse inquiète ou rebute admettent aujourd’hui que les habitudes et cérémoniaux subsistant de l’enfance jouent un rôle même dans le processus d’endormissement spontané, normal, et que le « coucher » met en jeu des facteurs infantiles autosuggestifs, qui seraient devenus inconscients en quelque sorte. Toutes ces considérations nous amènent à la proposition suivante : la première condition de réussite d’une hypnose est que le sujet trouve en l’hypnotiseur un maître, c’est-à-dire que l’hypnotiseur sache éveiller en lui les mêmes affects d’amour et/ou de crainte, la même foi aveugle en son infaillibilité que l’enfant éprouvait pour ses parents.
Pour éviter tout malentendu, nous devons souligner que la suggestibilité, c’est-à-dire la tendance à la confiance aveugle et l’obéissance nous paraît en rapport avec les propriétés psychiques similaires de l’enfance, sur un mode qui n’est pas seulement parental : nous estimons que l’hypnose et la suggestion réveillent véritablement « l’enfant qui sommeillent dans l’inconscient de l’adulte » (Freud).
(…) ( P. 119

les observations précédentes confirment l’opinion de Freud qui affirme que la crédulité et la docilité hypnotiques trouvent leur racine dans la composante masochique de l’instinct sexuel (« Trois essais sur la théorie sexuelle »). Mais le masochisme, c’est le plaisir d’obéir que les enfants apprennent de leurs parents. »
(Comme l’allusion à la gorgone Méduse revient plusieurs fois, on pourra aussi lire de Ferenczi le petit article de celui-ci : « Symbolisme de la tête de Méduse », écrit en 1923, dans « Psychanalyse. Œuvres complètes » (Ed. Payot). Tome III (1919-1926). Chap. XXX. (P. 200) )
Enfin, Carl Gustav Jung mentionne explicitement, mais malheureusement trop brièvement, le fait que l’on peut réellement induire le sommeil hypnotique grâce à une forte excitation d’ordre érotique :
« L’énergétique psychique » (éditions Le livre de poche)
Deuxième partie. Chap. II. Section D. (P. 194) :
« 2. L’excitation psychique. – On raconte que, lorsqu’elle rencontra Goethe pour la première fois, Bettina Brentano s’endormit soudain sur ses genoux.
Dans la littérature, cet endormissement à l’instant d’une excitation extrême a été exploité par Gustave Flaubert dans son roman Salammbô : après avoir conquis Salammbô dans de nombreux combats, le héros s’endort brusquement au moment où il effleure le sein de la jeune fille. »
Si (je dis bien : si…) nous suivons la logique de la psychanalyse, voulant que l’œil, et par extension le regard, est un symbole pour le phallus, alors il faudrait voir aussi dans la fascination par le regard de l’hypnose, où l’on plonge son regard profondément dans celui de l’autre, une représentation fantasmatique de la pénétration, sous une forme idéalisée, platonique.
Et les rythmes réguliers bien souvent propres à l’hypnose, tel qu’un tic-tac, et surtout les divers mouvements de va-et-vient souvent utilisés pour hypnotiser (tel que le balancement d'une montre à gousset, d'un pendule, etc…, par exemple), n’évoqueraient-ils pas le va-et-vient de l’acte sexuel ?…
Que dîtes-vous de tout cela ?