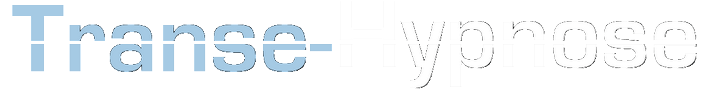Nodylion
Membre
- messages
- 206
- Points
- 4 110
En parcourant les forums et en discutant avec des amis psychothérapeutes, je me suis rendu compte qu'il existe beaucoup de confusions entre les titres, mais surtout qu'il y a un mythe concernant la supériorité des formations universitaires par rapport aux instituts privés en ce qui concerne la thérapie. Mon expérience (psychologue clinicien et psychothérapeute formé également en instituts privés) me montre qu'il n'en est rien.
D'abord les confusions.
- Médecin : personne qui a étudié 9 ans (généraliste) ou plus (spécialiste) le fonctionnement du corps et le traitement des maladies (pas de psychologie)
- Psychiatre : médecin qui s'est spécialisé 5 ans dans les psychopathologies et leur traitement (en grande partie pharmaceutique)
- Psychologue : il en existe plusieurs types (de l'éducation, du développement de l'enfant, social, clinique) et dans le reste du post je ne parlerai que des cliniciens ; personne qui a étudié le fonctionnement de l'esprit (cognition, mémoire, langage, sommeil, émotions), ses pathologies et certaines façon de les traiter
- Thérapeute : personne qui a étudié certaines thérapies (hypnothérapie, thérapies cognitivo-comportementales, PNL, Gestalt, etc.) dans un institut privé (contrairement aux autres qui ont étudié à l'université) et dont le ''diplôme'' n'est pas reconnu par l'état, ce qui n'enlève rien à la qualité des compétences acquises (en fonction des instituts) pour accompagner les personnes en difficultés psychologiques.
- Psychanalyste : personne qui a suivi (et accessoirement étudié) une psychanalyse
Examinons les programmes :
- Médecin : 9 ans : le corps (maladies, reproduction, médicaments, système nerveux, os, etc.). Pas de psychologie (pour une université j'ai trouvé 18 heures réparties entre le fonctionnement de la mémoire, le stress, les modèles cognitifs, le langage). Quand la mention ''thérapeutique'' apparaît, elle fait référence à quels médicaments administrer dans quels cas.
- Psychiatrie : comme médecine + 5 ans : description et classification des symptômes psychopathologiques, les différentes approches thérapeutiques (notamment pharmacologique, mais aussi psychodynamique, psychanalytique, cognitivo-comportementale et systémique) , les tests projectifs, la psychiatrie légale et les aspects psychologiques et psychiatriques des soins palliatifs.
- Psychologue clinicien : 3 ans de généralités : fonctionnement cognitif (mémoire, représentations, langage, etc.), neuro-anatomie (anatomie du cerveau et du système nerveux, fonctionnement des perceptions), développement psychologique, psychologie sociale, test, entretiens cliniques, psychopathologie (descriptions), psychologie clinique (histoire, ce qu'est l'entretien, etc.), histoire des différentes thérapies. Puis 2 ans (master) durant lesquels on étudie la neuropsychologie, les pathologies, la neuropsychiatrie, la méthodologie de l'enquête, l'entretien clinique, les conduites de groupes, les tests, les neurosciences cognitives, et durant un semestre universitaire (4-5 mois) 3 méthodes thérapeutiques parmi cognitivo-comportementale, systémique/familiale, psychanalytique, humaniste.
Comme on le voit, la partie à proprement thérapie est assez légère, et souvent les instituts de formation privés offrent des formations plus longues et plus complètes.
- Psychothérapeute : en fonction des professions, formation complémentaire en thérapie et stage.
Lire l'Article...
En vérité, un médecin n'est pas mieux placé que la boulangère du village à qui tout le monde va se confier car elle sait écouter ou que le prêtre auquel les croyants se confessent, pour aider les personnes en difficulté psychologique. Il n'a pour lui que cette mystérieuse aura d'autorité qu'on retrouve avec les avocats ou même les professeurs d'université (par rapport aux profs de collège). Ils ne sont en tout cas certainement pas les mieux placés pour demander à ce que le titre de psychothérapeute ou l'hypnose soient légiférés.
Quant aux psychologues cliniciens (qui pourraient demander ces légiférations), leur formation en thérapie est le plus souvent assez basique et ils complètent en instituts privés.
Maintenant comparons certains avantages présumés des formations universitaires par rapport à certains instituts privés :
- reconnaissance de l'état
- stages en institutions pour les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes
- éthique : les psychologues (et les médecins) ont un code déontologique. Oui, et alors ? Certains centres privés ont aussi un code, les fédérations internationales en ont aussi. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a un code déontologique qu'on va le respecter, ce serait trop beau.
- suivre sa propre psychothérapie (pour les psychologues cliniciens, les psychiatres et les psychothérapeutes) : c'est un prérequis pour la formation de certains instituts privés. Et comme certains l'ont fait remarqué sur ce forum, cela ne garantit rien.
Pour résumer on peut retenir que les formations universitaires ne sont pas forcément mieux que les formations en instituts privés : plus longues, plus de blabla inutile, et le versant thérapeutique est moins développé. Leur avantage : la reconnaissance par l'état. Mais en a-t-on vraiment besoin pour faire du bon boulot ?
D'abord les confusions.
- Médecin : personne qui a étudié 9 ans (généraliste) ou plus (spécialiste) le fonctionnement du corps et le traitement des maladies (pas de psychologie)
- Psychiatre : médecin qui s'est spécialisé 5 ans dans les psychopathologies et leur traitement (en grande partie pharmaceutique)
- Psychologue : il en existe plusieurs types (de l'éducation, du développement de l'enfant, social, clinique) et dans le reste du post je ne parlerai que des cliniciens ; personne qui a étudié le fonctionnement de l'esprit (cognition, mémoire, langage, sommeil, émotions), ses pathologies et certaines façon de les traiter
- Thérapeute : personne qui a étudié certaines thérapies (hypnothérapie, thérapies cognitivo-comportementales, PNL, Gestalt, etc.) dans un institut privé (contrairement aux autres qui ont étudié à l'université) et dont le ''diplôme'' n'est pas reconnu par l'état, ce qui n'enlève rien à la qualité des compétences acquises (en fonction des instituts) pour accompagner les personnes en difficultés psychologiques.
- Psychanalyste : personne qui a suivi (et accessoirement étudié) une psychanalyse
Examinons les programmes :
- Médecin : 9 ans : le corps (maladies, reproduction, médicaments, système nerveux, os, etc.). Pas de psychologie (pour une université j'ai trouvé 18 heures réparties entre le fonctionnement de la mémoire, le stress, les modèles cognitifs, le langage). Quand la mention ''thérapeutique'' apparaît, elle fait référence à quels médicaments administrer dans quels cas.
- Psychiatrie : comme médecine + 5 ans : description et classification des symptômes psychopathologiques, les différentes approches thérapeutiques (notamment pharmacologique, mais aussi psychodynamique, psychanalytique, cognitivo-comportementale et systémique) , les tests projectifs, la psychiatrie légale et les aspects psychologiques et psychiatriques des soins palliatifs.
- Psychologue clinicien : 3 ans de généralités : fonctionnement cognitif (mémoire, représentations, langage, etc.), neuro-anatomie (anatomie du cerveau et du système nerveux, fonctionnement des perceptions), développement psychologique, psychologie sociale, test, entretiens cliniques, psychopathologie (descriptions), psychologie clinique (histoire, ce qu'est l'entretien, etc.), histoire des différentes thérapies. Puis 2 ans (master) durant lesquels on étudie la neuropsychologie, les pathologies, la neuropsychiatrie, la méthodologie de l'enquête, l'entretien clinique, les conduites de groupes, les tests, les neurosciences cognitives, et durant un semestre universitaire (4-5 mois) 3 méthodes thérapeutiques parmi cognitivo-comportementale, systémique/familiale, psychanalytique, humaniste.
Comme on le voit, la partie à proprement thérapie est assez légère, et souvent les instituts de formation privés offrent des formations plus longues et plus complètes.
- Psychothérapeute : en fonction des professions, formation complémentaire en thérapie et stage.
Lire l'Article...
En vérité, un médecin n'est pas mieux placé que la boulangère du village à qui tout le monde va se confier car elle sait écouter ou que le prêtre auquel les croyants se confessent, pour aider les personnes en difficulté psychologique. Il n'a pour lui que cette mystérieuse aura d'autorité qu'on retrouve avec les avocats ou même les professeurs d'université (par rapport aux profs de collège). Ils ne sont en tout cas certainement pas les mieux placés pour demander à ce que le titre de psychothérapeute ou l'hypnose soient légiférés.
Quant aux psychologues cliniciens (qui pourraient demander ces légiférations), leur formation en thérapie est le plus souvent assez basique et ils complètent en instituts privés.
Maintenant comparons certains avantages présumés des formations universitaires par rapport à certains instituts privés :
- reconnaissance de l'état
- stages en institutions pour les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes
- éthique : les psychologues (et les médecins) ont un code déontologique. Oui, et alors ? Certains centres privés ont aussi un code, les fédérations internationales en ont aussi. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a un code déontologique qu'on va le respecter, ce serait trop beau.
- suivre sa propre psychothérapie (pour les psychologues cliniciens, les psychiatres et les psychothérapeutes) : c'est un prérequis pour la formation de certains instituts privés. Et comme certains l'ont fait remarqué sur ce forum, cela ne garantit rien.
Pour résumer on peut retenir que les formations universitaires ne sont pas forcément mieux que les formations en instituts privés : plus longues, plus de blabla inutile, et le versant thérapeutique est moins développé. Leur avantage : la reconnaissance par l'état. Mais en a-t-on vraiment besoin pour faire du bon boulot ?